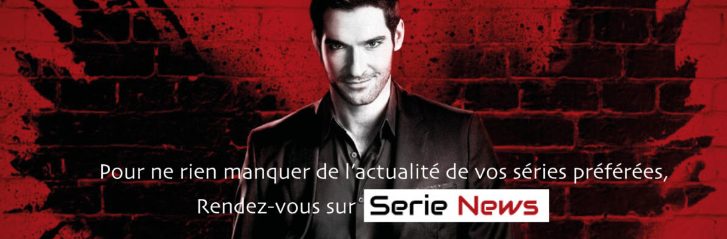Il arrive parfois qu’un film glisse entre les mailles de l’attention, pour mieux ressurgir quand l’époque est prête à l’écouter. Sorti discrètement en 2020, Body Cam (ici rebaptisé Police Officer Camera) fait aujourd’hui un retour fulgurant : il trône à la première place du Top 10 des films les plus vus du moment sur plusieurs plateformes, dont Netflix et Prime Video.
Dans un paysage saturé de récits policiers ultra-formatés, Body Cam choisit une autre voie : celle du trouble. Pas le thriller spectaculaire, ni le pamphlet politique frontal. Ici, c’est un malaise diffus, une angoisse qui se glisse entre les lignes — entre les plans granuleux d’une caméra corporelle et les silences d’un commissariat fatigué.
Une enquête où l’on regarde mais où l’on ne voit rien
Au centre du récit, Renee Lomito (jouée par Mary J. Blige, sobre, tendue, physique), vétérane de la police, enquête sur la mort brutale d’un collègue pendant une intervention routière. Très vite, quelque chose cloche : les images de la body cam enregistrent bien la scène, mais leur lecture laisse entrevoir autre chose. Une silhouette ? Une ombre ? Une trace qui n’est pas censée être là.
Ce n’est pas un polar classique. Pas de serial killer méthodique, pas de twist final. Plutôt une lente dérive. Un glissement entre réalité et hallucination, où la violence passée hante l’image elle-même. Chaque vidéo devient un piège, chaque souvenir un leurre.
Des morts suspectes et une mémoire impossible à effacer
Le scénario, signé Richmond Riedel et Nicholas McCarthy, bascule lentement vers le surnaturel. Une entité semble liée à une série de décès violents au sein même des forces de l’ordre. Mais plutôt que de verser dans le fantastique assumé, le film garde ses fantômes sous la surface — comme des fautes anciennes qui refont surface quand on pensait les avoir oubliées.
Ici, les spectres ne viennent pas punir les méchants. Ils viennent rappeler ce que l’institution refuse de regarder : la brutalité, l’abus de pouvoir, la disparition de ceux qui n’ont pas eu voix au chapitre.
Une mise en scène sobre, presque documentaire
Le réalisateur Malik Vitthal (Imperial Dreams) opte pour une réalisation nerveuse mais retenue. Pas de jump scares faciles. Juste des angles serrés, des lumières crues, des moments de silence qui durent une demi-seconde de trop. Le montage reproduit parfois les effets de défaillance des caméras embarquées : images brouillées, sons compressés, angles instables. Le spectateur regarde comme un policier regarde ses preuves : avec la peur d’y trouver ce qu’il ne veut pas voir.
Une performance organique de Mary J. Blige
La force du film repose en grande partie sur la présence de Mary J. Blige. Sans effets, sans pathos, elle incarne une flic éreintée, rongée par la culpabilité, qui doute à mesure qu’elle avance. Loin des performances héroïques, elle propose un contre-modèle de la policière : humaine, seule, perdue dans un système qui digère ses propres erreurs.
Fiche technique
- Titre original : Body Cam
- Réalisateur : Malik Vitthal
- Avec : Mary J. Blige, Nat Wolff, David Zayas, Anika Noni Rose
- Genre : Thriller psychologique, surnaturel
- Durée : 95 minutes
- Disponible sur : Netflix, Prime Video, Apple TV
- Année de sortie : 2020